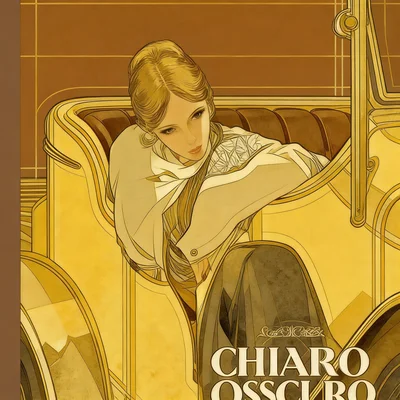L'atmosphère était lourde, des gouttes de sueur perlaient sur mes tempes. Je creusais la terre avec rage, mais sans réellement savoir pourquoi. J'étais dans un trou, ou plutôt une grotte, manifestement éclairée par les tréfonds. Une lueur rougeâtre et mouvante illuminait les parois incertaines de ce qui s'apparentait à un gigantesque tombeau. Tout mon corps était tétanisé de fatigue. Je me suis écroulé sur le monticule de pierres face à moi. Ma respiration était incroyablement difficile, de grandes bouffées d'air brûlant m'étouffaient en s'engouffrant dans ma gorge.
C'est là que j'ai vu que je n'étais pas seul. Il y avait des centaines, peut-être des milliers de personnes qui creusaient la roche sans relâche. Ils semblaient être là depuis une éternité. Leurs corps à demi-nus étaient véritablement décharnés. Aucune expression ne transparaissait sur leurs visages anguleux et dévastés. Je les observais au travail quand soudain mon plus proche voisin se retourna vers moi, le visage pétri de terreur. Et il me hurla avec une voix sourde, presque étouffée :
— Pourquoi t'as arrêté de creuser ? Pourquoi t'as arrêté ?
J'étais pétrifié par cet accès violent de panique. Quand soudain, des flammes surgirent du fond de l'immense dôme souterrain. Le feu semblait courir le long des parois, comme en pourchassant les zombies qui n'avaient pas cessé de creuser. Leurs corps s'étiolaient dans les flammes. Ils se froissaient comme des feuilles mortes en automne, jusqu'à disparaître en simple poussière. J'étais véritablement encerclé par le feu. Je me préparais à mourir carbonisé dans cette bouche de l'enfer, quand une sonnerie stridente, presque malfaisante, se fit entendre.
Mon lit était trempé de sueur. La lumière du soleil vint violemment s'engouffrir dans l'entrebaîillement de mes paupières et le téléphone, à côté de mon lit, se remit à hurler à la mort. Je décrochai avec violence l'appareil de son socle pour mettre fin à la douleur lancinante dans ma tête. Et sans grande conviction, je lançai un :
— Huummm ?? !!
Un hurlement inonda toute ma chambre. C'était l'inspecteur en second Rofflé. Il n'était manifestement pas très heureux. Il me dit simplement qu'il fallait que je sois Avenue des Cerisiers à Paris pour 10h30, et il raccrocha. L'horloge, sur le mur défraîchi de ma chambre, affichait fièrement 10h15. J'eus un léger sourire. J'en étais à présent certain : j'étais revenu en enfer.
Alors je me suis levé, les yeux encore gonflés de sommeil. Une bouteille de bière roula sous mon pied. Avec un léger mouvement d'humeur, je l'ai propulsée sous le lit avec les autres, et j'ai continué ma route vers la salle de bain. La faible ampoule électrique éclaira la petite pièce et me renvoya l'image d'un homme nu dans le fond de la salle. Il était plutôt mince et assez baraqué. Il avait le visage d'un homme que je n'aurais pas voulu croiser dans une ruelle sombre la nuit. Je m'avançai vers le lavabo. Je fis couler de l'eau pour m'en jeter au visage. En me relevant, je regardai l'homme qui me faisait face. Je l'avais connu en d'autres temps, mais il était devenu un véritable étranger, pour ne pas dire un paria. Nous nous sommes tourné le dos sans un mot et j'enfilai un vieux jean et un tee-shirt qui jonchaient le sol. Avant d'enfiler ma veste, je bus une bonne rasade de whisky qui était resté ouvert sur la table. Je pris mon flingue et je sortis.
La chose pratique des horaires décalés, c'est qu'au moins le métro n'est pas bondé. En m'installant en vrac sur la banquette, je repensais à mon coéquipier, Rofflé, qui avait le don pour m'énerver dès le matin. Il n'avait pas eu beaucoup de chance, il fallait bien le reconnaître. Sorti dans les dix premiers de l'école de police, il n'avait visiblement pas eu les faveurs du commissaire principal qui l'avait placé sous mon aile, comme il disait. J'en étais encore à me demander pour qui, de lui ou de moi, la punition était la plus forte.
Des cris me firent sortir de mes pensées. Une petite vieille était en train de se faire voler son sac par une espèce de skin ou je ne sais quoi. Il sortit de la rame, je fis de même pour me retrouver face à lui. Il ne m'avait pas prêté attention. Si bien qu'il fut surpris de prendre mon avant-bras dans les dents. Sous la violence du choc, il se retrouva à terre. Le train se remit en branle avec la petite vieille qui continuait de crier à l'intérieur. En le regardant de plus près, je vis qu'il portait des insignes nazis sur son blouson et qu'il avait des tatouages en allemand dont je présumais la signification. La journée était mal partie. Je déteste les fachos, et il en fit les frais. Les passants s'éloignaient sans rien dire alors que je lui balançais quelques bons coups de pied dans les côtes. Je le fouillai et je lui pris son portefeuille.
— Sylvain Bourbu, c'est ça ton nom, connard !
Je pris le peu d'argent qu'il avait et je jetai malencontreusement ses papiers sur la voie.
— Je crois que tu vas devoir justifier du fait que tu sois français, mon vieux ! T'es devenu sans papiers, on dirait !
Lui dis-je en riant nerveusement. Je l'ai traîné jusque sous un banc pour le menotter dessus.
Il me lança, la bouche tout ensanglantée :
— Mais t'es qui, bordel ?
— T'as qu'à m'appeler inspecteur Labavure !
Je pris le sac qui jonchait le sol avant de monter dans la rame qui venait d'arriver. En m'installant, je regardai le contenu du sac. Je fis le compte : il y en avait à peine pour 25 euros d'argent liquide dedans, un carnet d'adresses, les papiers, et une espèce de fond de teint. « Coquette, la mamie », me dis-je en souriant. Je pris l'argent et je refermai le sac.
Deux stations plus loin, trois cow-boys en uniformes firent leur entrée dans la voiture. En me dirigeant vers eux, je sortis ma carte de police et je leur dis :
— Salut, les gars, ça roule ?
Ils se retournèrent d'un air suspicieux et craintif. Je détestais ces gars-là au moins autant que le facho que je venais d'arrêter. Mais bon, ils étaient trois, et je n'avais pas que ça à faire. Je leur expliquai les faits en omettant quelques détails et je leur confiai le sac de ma petite vieille. Ils descendirent à la station suivante pour récupérer mon voleur à la tire.
Après deux changements de station, je refis enfin surface à deux rues de l'Avenue des Cerisiers. En arrivant sur place, je vis parmi les arbres qui bordaient la route un cordon de sécurité impressionnant, formé par une bonne dizaine de policiers en uniformes. Des journalistes étaient déjà sur place à guetter le moindre bout de cadavre ou quoi que ce soit de « sensationnel ». Je m'approchai en prenant soin de ne pas me faire repérer par tous ces fouille-merde qui ne me connaissaient que trop bien. Après avoir montré ma carte, un flic m'accompagna jusqu'à l'appartement en me donnant les premières informations capitales pour l'enquête : « J'avais jamais vu un truc pareil » ; « C'est pas beau à voir ».
J'entrai dans un couloir assez imposant, empli de toute la brigade criminelle du commissariat principal. Elle est composée de toute l'élite de la police française... et de moi. À mon entrée, le silence se fit dans la pièce. Beaucoup d'entre eux me haïssaient pour « l'image que je donnais de LEUR profession ». J'étais encore fatigué et j'avais faim quand Rofflé m'est tombé dessus.
— Eh bien enfin ! Je commençais à désespérer !
— Où est la cuisine ?
Il parut interloqué et répondit sans réfléchir :
— C'est la deuxième porte à gauche, mais le corps de la victime est dans le salon...
Sans rien ajouter, je me dirigeai vers la cuisine. C'était une vaste pièce. Le mobilier était moderne et fonctionnel, c'était un espace de vie à part entière. Rien ne semblait indiquer la présence d'enfants dans la maison et la nourriture que je trouvais dans le frigo était celle d'une femme qui devait prendre soin de son alimentation. Yaourts 0 %, crème fraîche allégée, bac à légumes rempli... En tous les cas, je ne trouvais aucun produit nécessaire à la survie d'un homme, comme la bière par exemple.
— Elle devait vivre seule ! Dis-je en fouillant dans les placards.
— Comment, tu sais ça ? Me demanda mon fidèle second qui m'avait suivi jusqu'ici.
— Oh ! Simple déduction ! Répondis-je en ouvrant un des placards.
— Allons voir ça ! Lançai-je sur un ton enjoué et en grignotant les céréales que je venais de trouver.
Le parquet en chêne qui recouvrait le sol de l'appartement avait dû coûter une véritable fortune. La décoration de l'appartement semblait épurée, mais à y regarder de plus près, le moindre petit bibelot devait coûter trois ou quatre mois de salaire d'un petit Cambodgien. En approchant du salon, j'aperçus la silhouette renfrognée de Laurent Mallet. Le médecin légiste, détaché aux affaires criminelles, arborait son air taciturne habituel. Pourtant, au premier coup d'œil, j'avais remarqué que quelque chose clochait chez lui. Il semblait préoccupé, lui si flegmatique, si froid, si coupé du monde. Quelque chose avait réussi à le troubler. Quand il me vit, il s'avança pour me saluer. Son visage n'exprimait rien d'autre que de la froideur et le dégoût de tout ce qui est vivant. Pourtant, je pense qu'il m'apprécie, mais son regard et sa présence donnaient une certaine lourdeur à l'atmosphère.
— Bonjour Franck ! Me lança-t-il.
— Salut ! Laurent, ça va ? Lui répondis-je en essuyant ma main sur mon jean pour lui serrer la main.
— On a affaire à un candidat sérieux. Il connaît nos méthodes de travail. Je n'ai trouvé aucune empreinte, aucune trace quelconque. Notre seule piste, c'est un cheveu retrouvé sur la victime.
— Et pour ce qui est de la victime, comment a-t-elle été tuée ?
Il esquissa un sourire :
— Viens, on va aller voir !